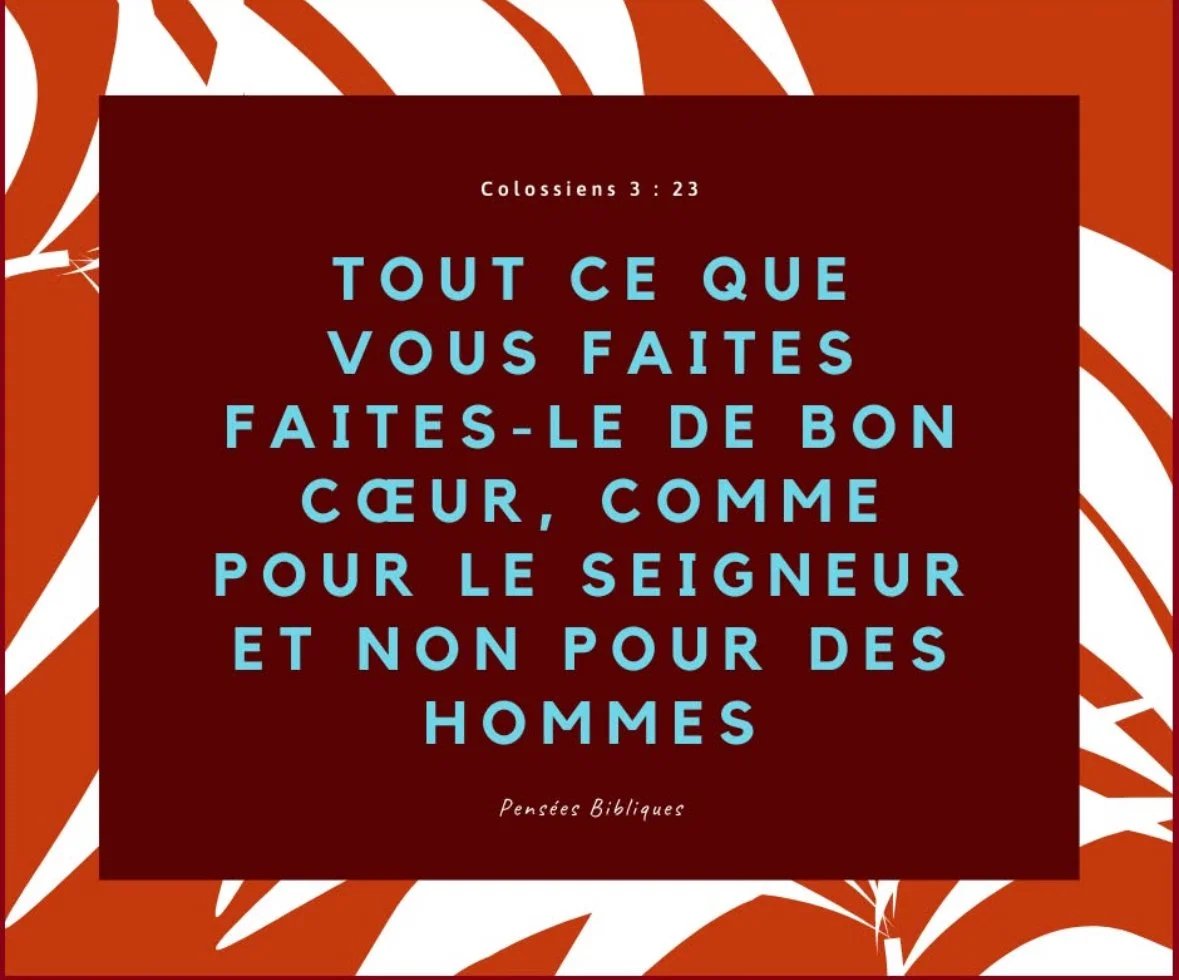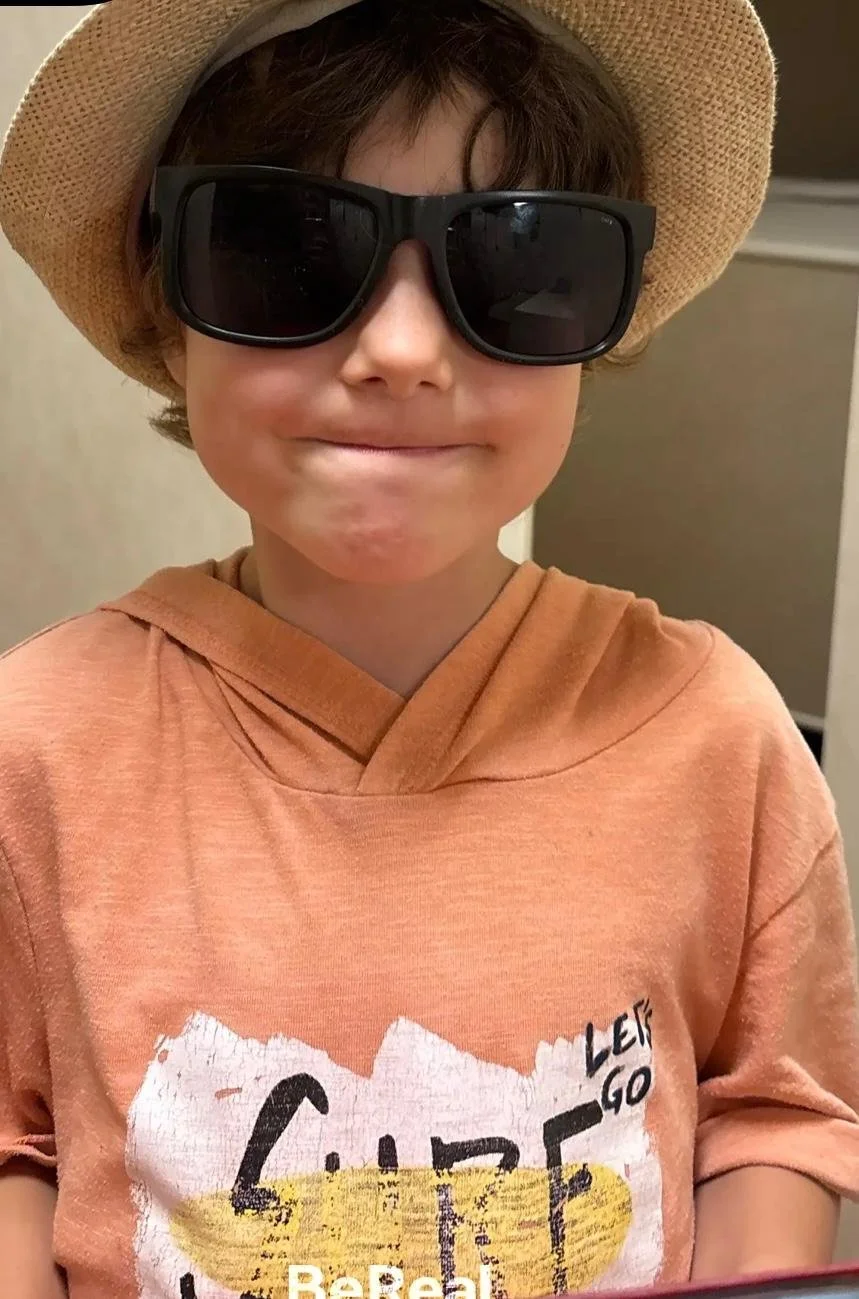Cher / chère Toi !
Je n'ai pas renouvelé mon abonnement Microsoft, si bien que je n'ai pas accès à Word. Je vais donc pondre cet article sur un e-mail que je m'enverrai à moi-même. Tout ça pour te dire qu'ici, à l'autre bout du monde, je rencontre le même type de défis que je rencontrais en Suisse - et que tu rencontres peut-être aussi, là où tu te trouves.
Comme annoncé dans le titre, cela fait pile poil un an maintenant que nous sommes sur l'Africa Mercy à Madagascar. Un an que je côtoie des diplodocus métalliques comme voisins et que je vis dans un ronron de chantier naval constant.
Heureusement, il y a plus à cette histoire que le fait de vivre dans un port industriel. Il y a aussi les sourires des patients, les couchers de soleil, les souvenirs créés avec nos enfants, le fait d'en apprendre tous les jours sur d'autres cultures, la satisfaction de sentir qu'on est "là où on doit être".
Nous avons eu la chance de rentrer quelques semaines en Suisse cet été et de faire le plein des choses qui nous ont manqué le plus : la famille, les amis proches, la maison, les chats, la raclette, les montagnes, l’herbe verte, les lacs, la forêt, les bougies, le silence, l'air pur, l'eau potable au robinet, le chant des oiseaux et j'en passe. Au début de ce bref passage en Suisse, nous avons eu l'occasion de parler de notre expérience à l'Eglise Evangélique de Bulle. Je vais donc profiter du bilan fait à ce moment-là pour te parler de notre première année :
Avant de parler, nous avons chanté un petit chant en malgache.
Jérémie nous avait proposé de parler chacun d'une chose que nous avions apprise durant notre première année sur Mercy Ships - mis à part l'anglais, que nous aurions tous pu citer ! Jules (qui n'a évidemment pas voulu parler - et a fait tout le chemin vers l'avant de l'église en nous suivant à quatre pattes) a appris à aller à l'école, à compter, lire et même à écrire un peu.
Marcel a appris qu'il y avait des gens à Madagascar qui étaient très pauvres. Il a raconté l'anecdote où il avait eu besoin d'une nouvelle paire de baskets et que par chance, on avait trouvé un stand qui en avait une avec sa pointure. Lorsqu'il l'a essayée, il s'est rendu compte que tous les enfants autour de lui jouaient dans la rue à pieds nus.
Sophie a parlé de son début sur le bateau qui avait été très difficile, parce qu'elle n'avait pas eu envie de venir. Aujourd'hui, elle a appris que parfois Dieu nous sort de notre zone de confort pour nous amener là où Il nous veut.
Jeanne, quant à elle, s'est fait des amies proches de trois cultures différentes : Canada, Etats-Unis et Kenya. Son horizon s'est donc bien élargi en termes de cultures différentes.
Jérémie a partagé que sa définition du succès a changé durant cette année. Il s’était préparé à sauter à pieds joints dans un travail qui allait être exigeant, mentalement prêt à se retrousser les manches. Arrivé à bord, il s’est vite rendu compte que son poste n’allait pas être si demandant que ça. Les équipes qu’il gère étant bien rôdées, les chefs d’équipe plus que compétents, il a eu l’impression que son job n’était pas vraiment utile. Sentant également qu’il n’avait pas une grande marge d’influence en termes de propositions de changement auprès de l’organisation, Jérémie s’est tourné vers Dieu en lui déversant sa frustration. “Pourquoi m’as-tu placé ici ? A quoi je sers ?” La réponse ne s’est pas fait attendre longtemps, mais elle était inattendue : “Est-ce que tu m’aimes ?” et “Est-ce que tu m’aimes plus que les dons que je t’ai donnés ?” Jérémie a ensuite entendu dans son coeur le même ordre que Jésus avait donné à Pierre : de prendre soin de “Ses brebis”. Cette conversation dans l’intimité a conduit mon homme à prendre part au travail de chaque membre de son équipe, afin de mieux comprendre ce qu’ils vivent. Comme déjà mentionné dans un autre article, Jérémie a passé des jours (et même une nuit !) à enfiler les différents costumes de travail des cinq départements qu’il gère, et à goûter au plaisir de laver les sols du bateau, de plier le linge de l’hôpital durant la nuit, de couper des carottes pour l’équipage, de servir des cafés au midship, de préparer des cabines pour des nouvelles arrivées etc.
L’autre manière de prendre part à la vie de ses 90 employés était de les faire défiler un à un dans son bureau, afin de les connaître plus personnellement et de mieux comprendre d’où ils viennent. Sa définition du succès a basculé en entendant l’histoire de certaines de ces personnes. Il a choisi d’en partager 3 : Nicolas, Mariana et Robert (prénoms d’emprunt).
Nicolas est malgache et travaille à la salle à manger. On le repère très vite, car c’est lui qui a le plus grand sourire quand il salue les gens. Nicolas a un cœur pour Dieu qui se manifeste dans ses chants. Il chante au travail, il chante dans les couloirs, il chante à l’église aussi. Sa voix vous transporte dès qu’il ouvre la bouche et ferme les yeux. Nicolas n’arrête pas de proclamer que Dieu est bon. Il y a 3 mois, son meilleur ami s’est fait assassiner pour des brindilles. Il allait se marier le samedi suivant – mais deux hommes qui en voulaient à son portemonnaie l’ont poignardé par derrière. Nicolas pleure son ami. Il continue pourtant de chanter. Au mois de juillet, quand nous étions en Suisse, on a appris que le grand frère de Nicolas était décédé, à la suite d'une maladie foudroyante. Nicolas continue de chanter. Jérémie a appris que la définition du succès, c’est de continuer à croire que Dieu est bon, même quand tout autour de nous voudrait nous faire croire l’inverse.
Mariana, malgache elle aussi, fait partie de l’équipe de nuit. Elle vient sur le bateau le soir, travaille à la buanderie de l’hôpital toute la nuit, et rentre chez elle le matin. Jérémie lui demande ce qu’elle faisait avant Mercy Ships. Mariana lui raconte qu’elle a ouvert une école avec son mari pour des enfants défavorisés. Ils fournissent un écolage et des repas chauds pour 150 enfants tous les jours. Quand elle quitte le bateau le matin, en fait, elle va rejoindre cette école pour enseigner ces enfants. Personne n’était au courant que derrière cette petite femme de ménage se cachait une directrice d’école qui se bat contre la misère de son pays. Jérémie a appris que la définition du succès, c’est de faire fidèlement ce à quoi tu es appelé, même lorsque cela signifie travailler dans l’ombre, loin des feux de projecteurs.
Robert est américain. Il est à la retraite. Durant les 20 dernières années de sa vie, il était CEO d’une entreprise de 250 personnes. Au lieu de siroter des cocktails sur un yacht ou d’aligner des hôtels cinq étoiles, Robert a choisi de s’engager deux ans sur Mercy Ships. La première année, il servait des cafés. Aujourd’hui, il travaille au “Hope Center” afin d’être plus proche des patients. (Remarque : le “Hope Center” est l’endroit où les patients logent avant et après les opérations - une sorte d’extension en ville de notre bateau.) Robert partage une chambre d’environ 20 mètres carrés, avec des lits superposés, avec cinq autres hommes. Jérémie a appris que la définition du succès, c’est le service. Et le service implique des sacrifices.
Quant à moi, j’ai introduit mon speech par cette citation d’un travailleur social anonyme, au Rwanda :
“Après avoir passé une semaine dans le pays, j’ai cru que je pourrais écrire un livre. Après six mois, j’ai cru que je pourrais écrire une histoire. Après un an, je ne sais pas quoi dire.”
En effet, il se sont passé tellement de choses en moi durant cette année que je peine à trouver des mots... J’ai tout de même réussi à sélectionner trois points que je peux partager.
Premièrement, je me suis souvenue qu’avant de venir sur le bateau, lors du programme de “On boarding” au Texas, ils nous avaient préparés au fait que l’environnement de communauté allait avoir un effet de loupe sur les problèmes que l’on rencontre chez soi. Je me souviens encore avoir pris ce constat en souriant, me disant que je n’avais pas vraiment de gros problèmes - que ça allait donc aller “ze finger in ze noze”. A peine quelques semaines plus tard, j’ai écrit en pleurant dans mon journal intime : “J’ai envie de rentrer en Suisse. Là-bas, au moins, j’ai des amis qui m’aiment !” suivi des phrases plus déchirantes encore : “Les relations, ça a toujours été mon point fort ! J’ai toujours réussi à faire en sorte que les gens m’aiment. Si les gens ne m’aiment pas, alors JE SUIS QUI ?!?”
Ces reflets de mon âme indiquaient clairement une crise identitaire. Tu te demandes peut-être ce qui avait causé tant de remises en question ? Eh bien, avec recul, j’ai compris que je souffrais d’un problème réel qui s’appelle “besoin de reconnaissance”. Lorsque je fais quelque chose pour quelqu’un, je m’attends à un “merci”. Lorsque j’apporte quelque chose au sein d’un groupe, je m’attends à être vue. Lorsque je contribue quelque chose, je m’attends à être félicitée. (En tapant ces mots à l’ordi j’ai déjà effacé trois fois mes phrases, tellement ça m’horripile d’avouer ça...) Peut-être que tu es en train de te dire que ce n’est pas si grave, au fond. Qu’on est tous comme ça. Eh bien crois-moi, j’ai réalisé grâce à cet effet de loupe qu’est le bateau, que chez moi, c’était tout de même un poil plus prononcé. J’ai compris que j’étais dépendante de paroles valorisantes, et que mon penchant naturel était de tout faire en sorte pour que j’en obtienne. Sauf que, grâce aux différences culturelles et aux nouvelles relations que j’ai tissées ici, Dieu m’a permis d’être privée (par moments) de ce shoot de dopamine – afin de comprendre ce dysfonctionnement intérieur. J’apprends donc gentiment à réfléchir à ma motivation avant de faire les choses, à ne les faire que si je sens qu’elles sont “justes en elles-mêmes” et à ne pas charger mon entourage d’une espèce d’attente de valorisation. J’apprends à lâcher prise sur l’effet que mes actes produisent, et à appliquer la sagesse de ce verset :
Deuxièmement, j’ai appris que de vivre dans un potpourri de nationalités et de cultures différentes s’apparente à un tour en voiture tamponneuse. On se fait constamment foncer dedans par tous les côtés, et on fonce aussi constamment dans d’autres voitures - même sans le vouloir. Des exemples ? La première fois que j’ai fait la lessive au Texas, j’ai découvert que quelqu’un d’autre avait pris ma place alors que je m’étais inscrite pour 10h. Je n’avais que 15 minutes de pause entre les enseignements et le bâtiment de la buanderie se trouvait à 5 minutes de marche de là où on avait les cours. Je suis donc retournée un peu frustrée à ma place, en calculant bien que dans 45 min, j’allais pouvoir lancer ma machine. Chose faite, et par-dessus le marché, je me suis dit que je n’allais pas en tenir rigueur à la personne qui m’avait volé mon créneau. Au contraire, je lui ai même mis sa lessive dans le sèche-linge, après avoir vérifié qu’il n’y avait que des t-shirts. Ma surprise était radicale quand j’ai été confrontée à la réaction de la miss. Au lieu d’être dans l’embarras ou reconnaissante, elle m’a fusillée du regard en disant que c’était une des règles de bases qu’on ne mettait jamais du linge de quelqu’un d’autre dans le sèche-linge ! (J’avais envie de lui répondre que là d’où je viens, c’est une règle de base qu’on ne pique pas le créneau des autres. Sinon, à quoi ça sert de s’inscrire ?!?)
Un autre exemple : j’ai dû m’habituer que les enfants anglophones sur le bateau m’appellent “Miss Valiton”. Même les enfants d’amis proches ! Je me souviens de la première fois que ça m’avait heurté. Mon amie Betty du Kenya disait à son fils : “Tu as dit merci à Madame Valiton ?” (Quelle horreur...!) Je lui ai tout de suite dit qu’il pouvait m’appeler Salomé, mais sa réponse était catégorique : “Non, parce que le jour où on retournera au Kenya, je ne veux pas qu’il ait perdu les bonnes manières.” Le coup de la voiture tamponneuse là-dedans ? Eh bien... Le fait que les adultes sur le bateau doivent sûrement se dire que les enfants Valiton n’ont pas de très bonnes manières - ils appellent tous les gens par leur prénom...
Oups…
Un dernier exemple : l’alcool. Avant de venir, je savais que pour des chrétiens américains conservateurs cela posait un problème. Je les trouvais bien étrange sur ce sujet. Ici, j’ai découvert que ce n’était pas une attitude réservée aux américains, mais que les gens de la plupart des pays d’Afrique partagent les mêmes valeurs. Autrement dit, pour eux, si on boit un verre d’alcool, c’est qu’on n’est pas vraiment chrétien. Depuis que j’ai découvert cette réalité (et aussi depuis que je travaille comme aumônière), je regarde toujours autour de moi, quand on va dans un restaurant. S’il y a quelqu’un du bateau qui est africain, je renonce à mon droit d’accompagner mon repas par un verre de vin, afin de ne pas heurter leur sensibilité.
La troisième chose que j’ai apprise durant cette année se résume en une phrase :
“Nous sommes des privilégiés - au coeur brisé.”
Privilégiés, car c’est tellement inédit de vivre cette aventure en famille. Privilégiés, car nous avons la chance d’être nés dans un pays comme la Suisse. Privilégiés, car nous avons le “beau rôle”, de pouvoir venir en aide aux plus démunis. Le cœur brisé, c’est la conséquence de situations dont on est témoin - dont on n’aurait jamais rien su en restant chez nous. Le cœur brisé, c’est quand on entend le témoignage de patients qui ont vécu avec leur tumeur qui grossissait durant des années, en se faisant marginaliser petit à petit au sein de leur communauté. Le cœur brisé, on l’a, quand on passe en voiture à côté de petits villages de brousse et qu’on voit avec quoi les gens vivent. Certains cassent des cailloux au bord de la route, comme des prisonniers, pour vendre du gravier. Ils gagnent 12 CHF par mois. (Le salaire moyen à Madagascar est de 60 CHF par mois...)
Le cœur brisé, c’est quand on se rend compte que la racine du problème de la pauvreté, c’est la corruption – et que le gouvernement en est le roi ! Le coeur brisé, je l’ai également en accompagnant des bénévoles sur le bateau, qui parfois traversent des horreurs dans leur vie personnelle.
Ma prière, c’est que ces cœurs brisés puissent apporter des petits éclats de compassion et d’amour aux gens autour de nous, afin de soulager leur peine et de rendre témoignage au cœur de Dieu qui souffre également avec chaque personne en souffrance. Le chirurgien David Chong (dont je t’avais parlé en novembre, dans cet article) définit l’amour ainsi :
“L’amour, c’est prendre le problème de quelqu’un d’autre, et en faire son propre problème.”
C’est sans doute cette définition de l’amour qui le motive à quitter sa vie confortable en Australie pour venir trois mois par année sur Mercy Ships depuis bientôt 30 ans (!), afin de redonner un vrai sourire à des personnes aux malformations maxillo-faciales.
Voilà le bilan après nos 12 premiers mois à bord de ce navire hôpital. Comme mot final, je tiens à dire que malgré les difficultés, nous sommes ravis d’entamer notre deuxième année de service ! L’avantage par rapport à l’année dernière, c’est que cette fois, nous faisons partie des “meubles”. C’est très gratifiant de constater que nous avons pris nos marques et que nous pouvons aider les nouveaux bénévoles à trouver les leurs.
Meilleures salutations,
Salomé
Ps : au niveau musical, notre été en Suisse se résume à cette chanson (Stand up, chanté par Cynthia Erivo). Tu connais ? On l’écoutait à plein tube dans la voiture, à la maison, à chaque occasion qui se présentait. Elle te rentre pas sous la peau aussi ?